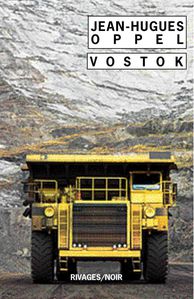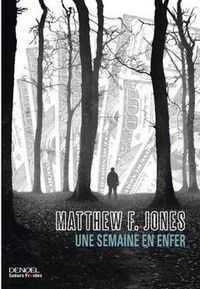On reproche souvent à la SF sa fausseté et sa naïveté. Sa propension à imaginer des futurs chimériques ne
débouchant sur rien de concret. Aux dires de ses détracteurs, le genre tiendrait plus d'une caverne d'Ali Baba dont le sésame ne serait accessible qu'autour de 14 ans.
C'est aller vite en besogne et oublier que la SF lorgne également du côté de la caverne de Platon,
accomplissant ce crime de lèse-pensée qui consiste à relier intelligence et plaisir, réflexion et divertissement, émotion et dépaysement. Et parfois, même si le genre n'a pas vocation à prédire
l'avenir, il arrive que celui-ci fasse mouche avec ses spéculations, preuve s'il en est, que la SF reflète son époque, poussant cet ancrage dans le présent jusqu'à en percevoir et en anticiper
ses évolutions.
Sous le barbarisme « Dyschroniques », les éditions du Passager clandestin, jusque-là
cantonnée à la critique sociale (autrement dit : des gauchistes !), inaugurent une collection d'œuvres de fiction. Des classiques de la SF, dont le propos se révèle a posteriori visionnaire.
Dirigée par Philippe Lécuyer, la collection démontre que les dérives d'hier sont désormais notre quotidien.
Certains trouveront peut-être les ouvrages un peu chers. L'initiative mérite toutefois d'être salué
puisqu'elle remet à disposition du lectorat des textes parfois difficiles à trouver. Elle bénéficie d'une présentation sobre que je trouve personnellement adaptée, et de l'ajout d'un para-texte
permettant de contextualiser l'œuvre et son auteur avec leur époque. À ceci s'ajoutent quelques suggestions de films et de livres. Bref, du nanan pour les curieux, ce que je suis, ça tombe
bien...
 La première recension comporte quatre textes : deux nouvelles et deux novellas. Un Logique nommé Joe de Murray Leinster
(dernière parution dans l'anthologie Demain les puces), La Tour des damnés de Brian Aldiss (dernière parution dans l'anthologie Histoires écologiques),
Le testament d'un enfant mort de Philippe Curval (dernière parution dans le recueil L'Homme qui s'arrêta) et Le Mercenaire de Mack
Reynolds (dernière parution dans le recueil Le livre d'Or de la science-fiction : La 3e guerre mondiale n'aura pas lieu). À n'en pas douter une sélection visant large et bien
peu de déchet, on va le voir.
La première recension comporte quatre textes : deux nouvelles et deux novellas. Un Logique nommé Joe de Murray Leinster
(dernière parution dans l'anthologie Demain les puces), La Tour des damnés de Brian Aldiss (dernière parution dans l'anthologie Histoires écologiques),
Le testament d'un enfant mort de Philippe Curval (dernière parution dans le recueil L'Homme qui s'arrêta) et Le Mercenaire de Mack
Reynolds (dernière parution dans le recueil Le livre d'Or de la science-fiction : La 3e guerre mondiale n'aura pas lieu). À n'en pas douter une sélection visant large et bien
peu de déchet, on va le voir.
Commençons par le texte le plus ancien, 1946 excusez du peu. Un Logique nommé Joe est un
classique de la SF, du genre incontournable. Si l'histoire peut paraître datée et simplette, on ne s'étendra pas dessus d'ailleurs, la clairvoyance de l'auteur reste quant à elle
troublante.
Avec le réservoir (autrement dit un serveur) et les logiques (des ordinateurs individuels
interconnectés), Murray Leinster anticipe ni plus ni moins le réseau informatique global actuel. Il en anticipe aussi l'aspect incontrôlable et devine l'importance qu'il a pris
dans la vie sociale et économique, au point de le devenir indispensable.
« Fermer le réservoir ? Réplique-t-il avec tristesse. Il ne vous est pas venu à l'idée, mon vieux, que le réservoir fait
tous les comptes de toutes les entreprises depuis des années ? Il distribue quatre-vingt-quatorze pour cent de tous les programmes télé, tous les bulletins météo, les horaires d'avion, les ventes
spéciales, les offres d'emploi et les informations ; ils s'occupe des contacts téléphoniques personnels et enregistre les conversations d'affaires et les contrats, voyons, mon vieux ! Les
logiques ont changé la civilisation. Les logiques sont la civilisation. Si nous éteignons les logiques, nous reviendrons à un type de civilisation que nous sommes incapables de gérer
! »
 Dix-sept ans plus tard, Mack Reynolds nous propose un futur lui-aussi daté, mais toujours pertinent dans sa dimension prospective. Si
l'on fait abstraction du contexte de Guerre froide, Le Mercenaire évoque en effet certains aspects de notre quotidien actuel.
Dix-sept ans plus tard, Mack Reynolds nous propose un futur lui-aussi daté, mais toujours pertinent dans sa dimension prospective. Si
l'on fait abstraction du contexte de Guerre froide, Le Mercenaire évoque en effet certains aspects de notre quotidien actuel.
Comme tout le monde le sait, l'Amérique représente le camp de la démocratie. Le capitaliste populaire
garantit la pérennité de son mode de vie envié partout sur la Terre. Chaque citoyen détient des actions dans les entreprises lui garantissant un minimum vital d'autant plus nécessaire que
l'automatisation de l'industrie a rendu le travail superflu.
Fin de l'Histoire ? On pourrait le croire, sauf que le système est biaisé. Des barrières sociales
infranchissables séparent la population en trois catégories : les Inférieurs, les Intermédiaires et les Supérieurs. Chacun naît dans sa classe, voire sa caste, et n'en sort que très rarement. De
toute façon, tout le monde est convaincu de vivre en Utopia, jouissant à satiété d'un toit, de nourriture, de distractions et de tranquillisants. Panem et circenses.
Pourtant la société n'est pas complètement figée. Pour les mécontents, insatisfaits de leur condition,
l'ascenseur social n'est pas en panne. Il peuvent gravir les échelons vers le sommet en suivant la voie cléricale ou la voie militaire. Dans les strictes limites fixées par les
Supérieurs...
Joseph Mauser appartient à cette catégorie de fâcheux. Il réprouve le système, mais pas au point de le
rejeter. Il préfère mettre à profit les nombreuses guerres entre entreprises privées pour s'élever dans la société. En fait, Mauser est un ambitieux refusant qu'on lui rogne sa liberté et sa
faculté d'agir.
Avec Le Mercenaire, Mack Reynolds anticipe la société du spectacle dans une
forme modernisée des jeux du cirque. Privée des moyens de se libérer (éducation et travail), la population est confinée dans une sorte de totalitarisme mou où les seules distractions sont
fournies par des guerres codifiées. Pas d'armes inventées au-delà de l'année 1910, histoire de ne pas braquer l'adversaire soviétique, dans ces affrontements sanglants censés régler les conflits
d'intérêt entre sociétés privées.
On le voit, ce futur un tantinet absurde revêt une dimension critique importante, rappelant la volonté
très américaine de libérer l'initiative individuelle et illustrant par là même la figure rhétorique du self made man.
Par ailleurs, Reynolds se mue en historien populaire, prolongeant dans l'avenir
l'histoire des luttes économiques et sociales aux États-Unis. Il met ainsi en évidence la part dominante de la violence dans ces oppositions, anticipant juste un peu sur leur évolution. Sur ce
point, on peut faire un parallèle avec Valerio Evangelisti (je pense ici à Anthracite et à Nous ne
somme rien soyons tout !). Quoi de plus naturel quand on sait que Reynolds a été élevé dans le socialisme, son père ayant même été le candidat à la présidence du
Socialist Labour Party.
« Le recours aux affrontements pour régler les disputes entre sociétés concurrentes, entre sociétés et syndicats ou entre
syndicats avait lentement évolué. Lentement, mais sûrement. Au début de la première révolution industrielle, ces conflits avaient souvent dégénéré, atteignant parfois la violence de conflits de
faible envergure. (…)
Au début du XXesiècle, les syndicats étaient devenus une des plus grandes forces du pays. Un
nombre considérable de conflits industriels dégénéraient en véritables batailles, qui opposaient ces syndicats sur les statuts juridiques de leurs membres. Les bagarres sur les quais, les
assassinats, les représailles exécutées par des casseurs armés et menés par des gangsters, le sabotage industriel, les rixes entre les grévistes et jaunes étaient monnaie
courante. »
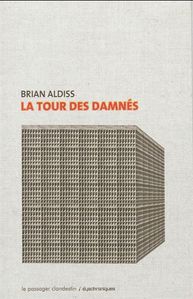 On ne change pas de décennie avec le texte de Brian Aldiss. La Tour des Damnés relève de cette spéculative fiction britannique davantage
préoccupée par les sciences humaines que par les visions vertigineuses du space opera.
On ne change pas de décennie avec le texte de Brian Aldiss. La Tour des Damnés relève de cette spéculative fiction britannique davantage
préoccupée par les sciences humaines que par les visions vertigineuses du space opera.
Cette novella reflète bien son époque puisqu'il y est question de surpopulation. Bien sûr, sur un sujet
similaire, on pense tout de suite à Tous à Zanzibar de John Brunner, aux Monades urbaines de Robert Silverberg, voire à IGH de
Ballard.
Si La Tour des Damnés partage une parenté incontestable avec ces romans, l'ampleur spéculative y
paraît plus étriquée. La faute au format, sans doute, la faute aussi à un argument science-fictif quelque peu nébuleux. Toutefois, les réflexions suscitées par Aldiss n'en
demeurent pas moins stimulantes.
À la mi-temps des années 1970, sous l'égide du CERGAFD (le Centre Ethnographique de Recherches sur les
Groupes à Forte Densité), 1500 couples ont été enfermés dans une tour en Inde. Vingt cinq plus tard, la population atteint le chiffre de 75 000. Sans contact avec l'extérieur, si ce n'est pour
leur alimentation et la diffusion en circuit fermé des mêmes programmes télés, le monde de la tour a évolué, développant des facultés étonnantes, comme cet étrange accélération de la croissance
(la puberté et la vieillesse se produisant bien plus tôt) ou ces pouvoirs extra-sensoriels. Les habitants se sont forgés une identité forte, redoutant et refusant les interventions de
l'extérieur, toutes considérées comme des agressions intolérables. À tel point que les observateurs infiltrés dans la tour sont impitoyablement exécutés.
Thomas Dixit, un des observateurs de ce microcosme vertical, s'insurge contre des conditions de vie qu'il
juge dégradantes. Promiscuité, esclavage, conflits sanglants, il se porte volontaire pour infiltrer les lieux, convaincu de rassembler suffisamment d'éléments pour les faire fermer. À ses yeux,
cette expérience de sociologie appliquée n'a que trop duré.
On ne peut s'empêcher de percevoir dans La Tour des Damnés comme un écho des rapports Nord-Sud.
Entre le microcosme tiers-mondiste de la tour et le monde d'abondance des observateurs se développe un sentiment de répulsion et de fascination. Pour Thomas Dixit, il ne fait aucun doute que
l'expérience doit cesser. Le bonhomme incarne la bonne conscience occidentale, oscillant entre devoir d'ingérence et respect d'autrui, entre hypocrisie et humanisme. Une position dont il goûtera
les fruits amers de la désillusion.
« Dites-leur, dites à tous ceux qui passent leur temps à nous espionner et à se mêler de nos affaires, que nous sommes
les maîtres de notre destin. Nous savons ce que l'avenir nous réserve et quels sont les problèmes qui résulteront de l'accroissement du nombre des jeunes. Mais nous faisons confiance à notre
prochaine génération. Nous savons qu'ils possèderont de nouveaux talents que nous n'avons pas, de même que nous possédons des talents que nos pères ne connaissaient pas. »
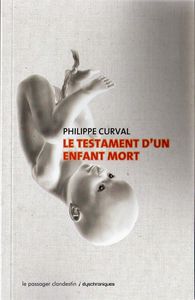 Le Testament d'un enfant mort se distingue des textes précédents par son registre intimiste et une langue très travaillée. L'aspect politique
apparaît beaucoup plus lointain, pour ne pas dire anecdotique. Philippe Curval semble surtout se livrer ici à un exercice de style.
Le Testament d'un enfant mort se distingue des textes précédents par son registre intimiste et une langue très travaillée. L'aspect politique
apparaît beaucoup plus lointain, pour ne pas dire anecdotique. Philippe Curval semble surtout se livrer ici à un exercice de style.
Certes, on peut lire dans la vie accélérée des nouveau-nés « hypermaturés » comme une métaphore
de l'évolution des sociétés humaines. Accélération de l'Histoire (elle s'écrit dit-on en direct), course effrénée à la consommation de biens, d'amis et de conjoints, on connaît le refrain. Une
urgence permanente, proclamée jusque dans l'intimité.
Malheureusement, je ne peux m'empêcher de trouver Le Testament d'un enfant mort froid, dépourvu
de toute empathie. L'exemple parfait d'un texte trop maîtrisé, poli, lissé, jusqu'à l'atonie.
« En chiant vingt fois plus vite qu'il n'est possible, j'userai mon organisme jusqu'à ce qu'il cède, je brûlerai mon
corps jusqu'à la dernière molécule, je mordrai mon pouce jusqu'au sang afin qu'il meure avec moi dans orgie de sympathie avec ma bouche. Je démontrerai au monde que je peux le nier. Ce qu'en
revanche, il ne peut pas faire à mon égard. »
Au final, même si l'on peut juger la collection chère, les « Dyschroniques » offre un panorama
de classiques de la SF diablement convaincants, pour ne pas dire indispensables.
Un aperçu sur le genre, loin des clichés habituels qu'il véhicule.
Un Logique nommé Joe [A Logic named Joe, 1946] de Murray Leinster – Le passager clandestin, collection
« dyschroniques », février 2013
Le Mercenaire [Mercenary, 1962] de Mack Reynolds – Le passager clandestin, collection
« dyschroniques », février 2013
La Tour des Damnés [Total Environment, 1968] de Brian Aldiss – Le passager clandestin, collection
« dyschroniques », janvier 2013
Le Testament d'un enfant mort de Philippe Curval – Le passager clandestin, collection
« dyschroniques », janvier 2013
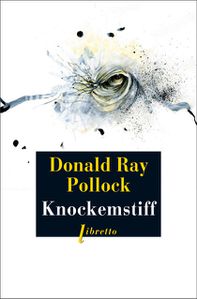




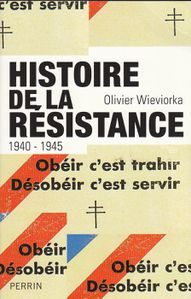




 La première recension comporte quatre textes : deux nouvelles et deux novellas. Un Logique nommé Joe de Murray Leinster
(dernière parution dans l'anthologie Demain les puces), La Tour des damnés de Brian Aldiss (dernière parution dans l'anthologie Histoires écologiques),
Le testament d'un enfant mort de Philippe Curval (dernière parution dans le recueil L'Homme qui s'arrêta) et Le Mercenaire de Mack
Reynolds (dernière parution dans le recueil Le livre d'Or de la science-fiction : La 3e guerre mondiale n'aura pas lieu). À n'en pas douter une sélection visant large et bien
peu de déchet, on va le voir.
La première recension comporte quatre textes : deux nouvelles et deux novellas. Un Logique nommé Joe de Murray Leinster
(dernière parution dans l'anthologie Demain les puces), La Tour des damnés de Brian Aldiss (dernière parution dans l'anthologie Histoires écologiques),
Le testament d'un enfant mort de Philippe Curval (dernière parution dans le recueil L'Homme qui s'arrêta) et Le Mercenaire de Mack
Reynolds (dernière parution dans le recueil Le livre d'Or de la science-fiction : La 3e guerre mondiale n'aura pas lieu). À n'en pas douter une sélection visant large et bien
peu de déchet, on va le voir. Dix-sept ans plus tard, Mack Reynolds nous propose un futur lui-aussi daté, mais toujours pertinent dans sa dimension prospective. Si
l'on fait abstraction du contexte de Guerre froide, Le Mercenaire évoque en effet certains aspects de notre quotidien actuel.
Dix-sept ans plus tard, Mack Reynolds nous propose un futur lui-aussi daté, mais toujours pertinent dans sa dimension prospective. Si
l'on fait abstraction du contexte de Guerre froide, Le Mercenaire évoque en effet certains aspects de notre quotidien actuel.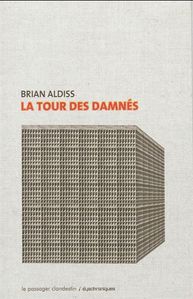 On ne change pas de décennie avec le texte de Brian Aldiss. La Tour des Damnés relève de cette spéculative fiction britannique davantage
préoccupée par les sciences humaines que par les visions vertigineuses du space opera.
On ne change pas de décennie avec le texte de Brian Aldiss. La Tour des Damnés relève de cette spéculative fiction britannique davantage
préoccupée par les sciences humaines que par les visions vertigineuses du space opera.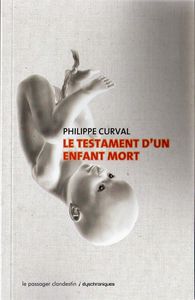 Le Testament d'un enfant mort se distingue des textes précédents par son registre intimiste et une langue très travaillée. L'aspect politique
apparaît beaucoup plus lointain, pour ne pas dire anecdotique. Philippe Curval semble surtout se livrer ici à un exercice de style.
Le Testament d'un enfant mort se distingue des textes précédents par son registre intimiste et une langue très travaillée. L'aspect politique
apparaît beaucoup plus lointain, pour ne pas dire anecdotique. Philippe Curval semble surtout se livrer ici à un exercice de style.