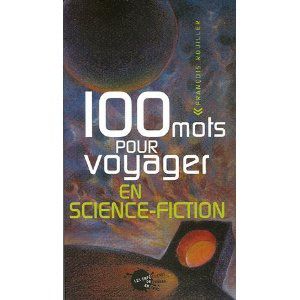Baladé d'un bout à l'autre de la vallée de Pomona – la vallée du Marasme accéléré –, Earl Dean vend des aspirateurs. Le plus vieux métier du monde de la consommation. Des cyclones, fine fleur de la technologie domestique, dotés d'une puissance d'aspiration pouvant leur servir à purifier l'air ambiant.
Si la malchance pouvait se porter comme un étendard, Dean incarnerait le porteur idéal. La quarantaine bien frappé, il n'a jamais fait grand chose de son existence. Ultime héritier d'une famille de riches planteurs d'oranger, il se cantonne à des petits boulots sans attrait. De quoi manger et payer ses factures, l'ambition dans les chaussettes. Aussi loin qu'il se souvienne, les choses ont commencé à mal tourner avec son arrière-grand-père, abattu d'une balle dans le poumon à un endroit où il n'aurait pas du se trouver. C'est à partir de ce drame que les événements ont viré en eau de boudin pour sa famille. Et il faut croire que la poisse n'en a pas fini avec lui.
Envoyé faire une démonstration du fabuleux Cyclone chez un client potentiel, il tombe sur une connaissance remontant à ses années lycée. Dan Brown, le mauvais garçon. Un taré à la réputation de cogneur. Un psychopathe capable d'expédier ad patres n'importe qui pour n'importe quoi. Comble de malchance, la brute est en deuil. Le corps de son frère git raide dans une glacière au milieu du séjour, le bide ouvert par un coup de couteau. L'heure n'est plus aux démonstrations commerciales. L'heure est aux représailles. Une vengeance à laquelle Dean se voit contraint de participer.
Comme pour Surf City, La reine de Pomona suit une trame classique : mauvaise rencontre au mauvais endroit, périple chaotique ponctué de violence. Les ressorts utilisés par Kem Nunn ne flattent pas l'amateur de nouveauté.
La différence apparaît plutôt au niveau du traitement. L'auteur californien prend son temps, écartant toute velléité de suspense ou de rythme haletant, comme on dit chez les adeptes du thriller. Il alterne les digressions, parsème son récit de détails d'apparence anodine, détails contribuant pourtant à définir les personnages. Il laisse infuser au travers des descriptions et des plongées dans le passé l'histoire de la vallée de Pomona. On se trouve dans un registre privilégiant davantage l'intuition, l'introspection, et ne se souciant guère des scènes d'action. Toutefois, lorsqu'elles surviennent, Kem Nunn ne ménage pas leur traitement. Sèche, viscérale, dépourvue de toute théâtralisation, la violence marque les corps et les esprits.
L'argument de départ de La reine de Pomona sert de prétexte. Prétexte à un long voyage au cœur de la vallée de Pomona. Périple dans le passé et les rêves manqués. Le temps passe broyant les hommes et leurs projets. Rien ne dure éternellement. Il gâche les espoirs et use les résolutions. Pourtant, il faut bien continuer à avancer. Ainsi, la vallée de Pomona offre comme un écho à l'histoire personnelle de Dean. La longue nuit qu'il passe en compagnie de Dan Brown lui permet de faire le bilan de son existence.
D'une certaine façon, La reine de Pomona suit le même schéma que Surf City. Un passé mythique provoquant la nostalgie. Des hommes ballotés entre ce passé et un présent désenchanté. La relation compliquée entre les pères spirituels et leurs héritiers. Kem Nunn semble affirmer que l'on ne vit pas dans le passé mais que l'on ne vit pas non plus en se coupant de son passé.
« Le Marasme accéléré avait fait son apparition, manifestation à la fois physique et prophétique d'un malaise bien plus important. Le virus s'attaquait aux racines. L'arbre ainsi coupé de la base de son existence mourait rapidement, souvent en quelques jours. On comprenait comment ça fonctionnait. Avec l'aide de la Old English 800. »
Au final, même si j'ai eu plus de mal à entrer dans ce roman, je ne regrette pas le bout de chemin accompli avec Earl Dean dans la vallée de Pomona.
La suite bientôt avec Le sabot du Diable. Un roman dont j'ai entendu dire grand bien.

La reine de Pomona [Pomona Queen, 1992] de Kem Nunn – Reed. Gallimard, coll. Folio/Policier, 2004 (roman traduit de l'anglais [Etats-Unis] par Jean Esch)






 Dans le panthéon des Génies du Mal, Baron Samedi se taille (au scalpel) une place de choix.
Dans le panthéon des Génies du Mal, Baron Samedi se taille (au scalpel) une place de choix.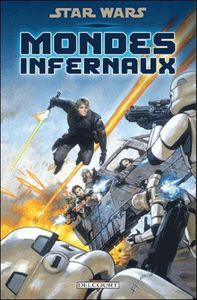 Dans une galaxie très proche, la nôtre en fait, à l'hyper
du coin de la rocade, pas plus tard qu'hier, mon regard dans le vague a accroché la couverture du nouveau produit dérivé SW édité par Delcourt, débarqué fraîchement sur l'étalage du
boucher... du libraire, je veux dire.
Dans une galaxie très proche, la nôtre en fait, à l'hyper
du coin de la rocade, pas plus tard qu'hier, mon regard dans le vague a accroché la couverture du nouveau produit dérivé SW édité par Delcourt, débarqué fraîchement sur l'étalage du
boucher... du libraire, je veux dire.