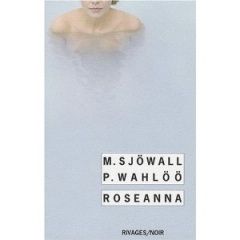« Enfin, à 2 heures 12, dans un gros trou entouré de collines, on aperçut les milliers de lumières de Nancy, capitale écrasée de la Meurthe-et-Moselle. Et Stéphane Anselme débarqua ainsi dans la glorieuse cité des Ducs de Lorraine, la sage et fière patrie des mirabelles et des macarons, de Stanislas et de Rossinot, de Virginie Despentes et de C. Jérôme. »
Amis de jeunesse, Stéphane, Maude, Raoul et Guillaume ont connu un parcours similaire. Des projets plein la tête, mais l'échec sur toute la ligne. Révoltés par choix, ils ont arpenté le bitume dans les manifestations contre le CPE, côtoyé le milieu anarchiste, pogotés à des concerts punks improvisés dans des squats, tout en consommant bière et substances illicites. Et puis, Stéphane est mort, suite logique de sa trajectoire auto-destructice. Ses amis ont poursuivi leur route, chacun de son côté. Maud roulant sa bosse en Amérique latine, Guillaume entre alcoolisme et petits boulots, Raoul enfermé dans son appartement rempli de livres, à noircir des pages avec des théories politiques absconses. Jusqu'au retour de Maude au bercail.
Ces derniers temps, le néo-polar hexagonal semble reprendre des couleurs. Entendons-nous bien, je parle ici du néo-polar tel que le pratiquaient Manchette ou ADG, pas de ce prétendu roman d'intervention sociale au propos gauchiste trop souvent caricatural.
DOA, Manotti, Leroy, Di Rollo, Guez, Di Ricci et j'en passe... Les auteurs ne manquent pas pour ausculter les angles morts de la société française, établissant le diagnostic de ses difficultés, de ses tensions et de ses maux. Pierre Brasseur s'inscrit dans cette mouvance – terme approprié au regard du sujet qu'il aborde dans son roman.
En effet, Je suis un terroriste se focalise sur une certaine jeunesse, marginale, dégoûtée de tout et n'envisageant l'avenir que sous la forme d'un déchaînement de violence aveugle, catharsis de ses frustrations et de ses échecs.
Passé les quelques sources d'agacement, clichés – j'avoue avoir trébuché sur le regard glacé – et autres coquilles typographiques, j'ai été happé par l'intrigue, compte-rendu clinique et détaillé écrit a posteriori d'un point de vue omniscient. D'emblée, on sait que l'histoire va mal de terminer. L'auteur le rappelle à plusieurs reprises, anticipant sur le déroulement des faits, et pourtant la narration extérieure convient idéalement au propos. Elle colle à la trajectoire de ces trois trentenaires, en rupture de ban, embarqués dans la spirale du nihilisme, décidant sur un coup de tête d'assassiner des inconnus, pour le simple motif qu'ils appartiennent au MEDEF. Le fait illustre bien le désespoir de ces révoltés par dépit, animés par la colère et le dégoût. À défaut d'ennemis identifiables ou d'idéal à promouvoir, ne reste plus qu'à tirer dans le tas, offrant ainsi à l'Etat l'opportunité de tirer les marrons du feu...
On le voit, le parallèle avec Nada de Jean-Patrick Manchette n'est pas usurpé. À l'heure des blacks blocks, des sabotages de lignes TGV, plus que jamais le terrorisme gauchiste et le terrorisme étatique, quoique tous mobiles soient incomparables, restent les deux mâchoires du même piège à cons.
Cependant, si j'adhère au propos de Pierre Brasseur, je ne peux m'empêcher d'être plus critique quant à sa forme. L'auteur ne respecte pas complètement le pacte établi avec le lecteur. La quatrième de couverture parle à tort de style comportementaliste. Je m'inscris en faux en signalant que dans le béhaviorisme (je néologise si je veux), les personnages ne se caractérisent que par l'action, par leurs rapports avec l'environnement et leurs interractions. Les états d'âme, les processus mentaux, l'introspection ou la mémoire ne doivent pas venir interférer, comme cela est le cas avec Je suis un terroriste.
Par ailleurs, je trouve le dénouement un tantinet capillotracté. La fuite de Maude, sa rencontre fortuite sur l'autoroute (drôle d'endroit pour une rencontre.)... Sans déflorer davantage l'histoire, j'ai trouvé que tout cela sonnait faux. Trop facile. C'est bien sûr un ressenti personnel.
Toutefois, il n'en demeure pas moins que Je suis un terroriste est un roman à lire. Au moins, pour le portrait d'une jeunesse désabusée, en rupture d'idéal et de perspective d'avenir. Pas sûr que les lendemains de cette insurrection qui vient soient enchanteurs...

Je suis un terroriste de Pierre Brasseur – Éditions Après La Lune, collection Lunes blafardes, février 2011






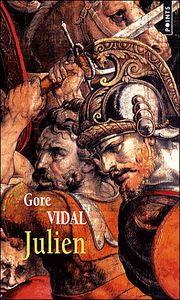


 Parallèlement au projet Le roman du crime développé avec sa compagne Maj Sjöwall, Per Wahlöö poursuit une carrière
en solo. Auteur de quelques romans très politiques, à la limite du pamphlet, activité qui lui vaudra d'être expulsé de l'Espagne franquiste, il fait paraître, entre 1964 et 1968, un diptyque
prenant pour personnage un enquêteur guère loquace : le commissaire Peter Jensen.
Parallèlement au projet Le roman du crime développé avec sa compagne Maj Sjöwall, Per Wahlöö poursuit une carrière
en solo. Auteur de quelques romans très politiques, à la limite du pamphlet, activité qui lui vaudra d'être expulsé de l'Espagne franquiste, il fait paraître, entre 1964 et 1968, un diptyque
prenant pour personnage un enquêteur guère loquace : le commissaire Peter Jensen.